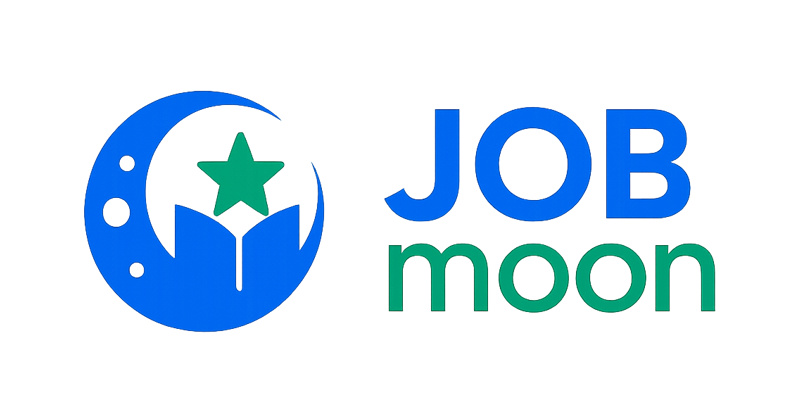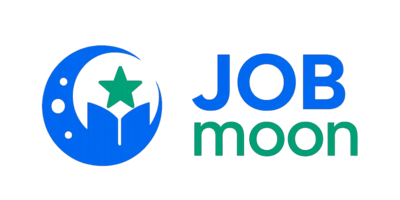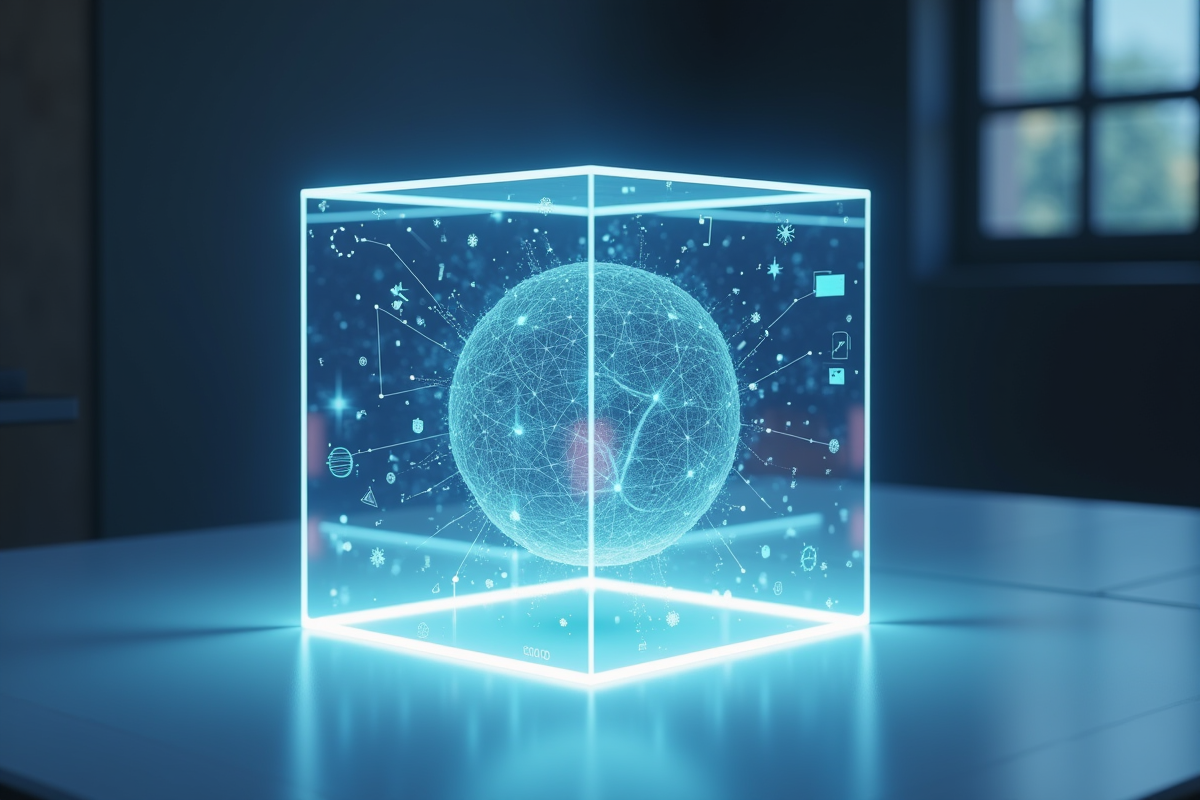Poser que la connaissance se bâtit uniquement sur des équations, c’est oublier la force du récit. Derrière chaque prédiction algorithmique, il y a une histoire qu’on ne raconte pas, des choix qui orientent le regard et dessinent la frontière entre calcul et compréhension.
Ici, deux manières d’appréhender le monde s’entrechoquent sans cesse. Le modèle narratif avance au fil d’une suite d’événements, faisant jouer causes et conséquences, tissant chaque étape pour donner sens à ce qui advient. À l’opposé, le modèle numérique s’autorise toutes les abstractions ; il tronçonne la réalité en variables, la comprime en équations, choisissant l’efficacité de la manipulation et la puissance de la prédiction. Entre ces deux horizons, les chercheurs en intelligence artificielle décident, chaque fois, jusqu’où aller dans la précision ou dans la lumière jetée sur la compréhension. Car simulations et analyses croisent sans relâche calculs pointus et récits structurants, tour à tour rivaux ou alliés.
Les chiffres donnent l’avantage au numérique : capacité d’anticipation, force de la mesure, froideur du constat. Mais l’explication, elle, glisse entre les doigts. Le modèle narratif, en revanche, rend intelligible le pourquoi, quitte à tordre un peu la réalité pour qu’elle entre dans le cadre rassurant d’un récit cohérent. Cette tension entre raconter et calculer façonne en profondeur notre manière d’analyser des phénomènes complexes et de formuler un savoir qui ne soit pas qu’une suite de chiffres.
Modèles narratifs et modèles numériques : quelles différences fondamentales dans la construction du savoir ?
Pour cerner ce qui sépare ces deux mouvements de pensée, il faut d’abord revenir à leurs fondements. Depuis toujours, les modèles narratifs occupent une place de choix dans les sciences humaines. Ils offrent un déroulé clair, relient les faits, et placent chaque hypothèse dans un cheminement logique. Un point de départ, des arguments qui se succèdent, et, au bout, un sens émerge. Le récit, ici, sert de fil directeur et prolonge la tradition d’une réflexion héritée de la philosophie des sciences.
En face, le modèle numérique bouscule les repères du narratif. Plus question de raconter : tout passe dans la moulinette de l’équation, chaque paramètre s’inscrit dans une architecture mathématique rigoureuse. L’objectif devient la validation, l’isolement des variables, la quantification. Les disciplines qui manipulent l’information s’emparent de ce formalisme, cultivant la logique et la solidité d’un raisonnement qui ne laisse rien au hasard.
Cette dissociation, soulignée entre autres par Umberto Eco, irrigue toujours la fabrique du savoir. Les sciences humaines privilégient les histoires de contexte ; la nature, elle, s’explique par la déduction pure. Pourtant, la séparation s’effrite. À l’heure où les modèles se multiplient, cette hybridation semble inévitable : il s’agit aujourd’hui de démêler comment ces deux démarches, longtemps opposées, s’articulent pour édifier des raisonnements capables de s’appuyer sur des données parfois imparfaites.
Simulations scientifiques et intelligence artificielle : le rôle clé des modèles numériques pour expliquer et prédire
Dans les laboratoires, c’est le modèle numérique qui prend les commandes des simulations scientifiques. Son avantage : absorber la complexité, tout traduire en paramètres, donner à chaque hypothèse la rigueur d’un test mathématique. Cette méthode s’applique partout, de l’astrophysique à l’économie, du climat à la sociologie, et permet de tester hypothèses, jouer avec des scénarios, peaufiner des prédictions.
L’arrivée en fanfare de l’intelligence artificielle a encore amplifié cette logique. Le deep learning, en particulier, brasse des quantités de données que l’humain regarderait sans voir, capte des motifs sans en donner la recette. Derrière les prouesses techniques, la structure demeure : il s’agit toujours de bâtir des modèles, qu’il soit question d’épidémie mondiale ou de micro-choix quotidiens.
Dans le champ des sciences sociales par exemple, la simulation devient l’outil idéal pour tester la solidité d’une théorie ou prévoir les réactions collectives. Une dynamique faite d’allers-retours : on affine le modèle, on le confronte, on revient sur ses bases. Cette évolution redéfinit peu à peu la façon de penser et d’expliquer, tout en montrant que chaque démonstration repose sur une sélection rigoureuse des paramètres à retenir… ou à écarter.
S’il n’existe pas de modèle numérique universel, chaque simulation s’inscrit pourtant dans un filet de décisions : tel facteur mis en avant, telle donnée laissée de côté. Concevoir un bon modèle, c’est accepter de s’interroger, d’analyser à chaque étape ce qui fonde la pertinence du raisonnement.
Peut-on vraiment faire confiance aux modèles numériques ? Éclairages et limites pour un raisonnement critique
Penser qu’un modèle numérique fournirait une vérité brute est illusoire. Leur efficacité impressionne ; leur opacité, parfois, inquiète. Dès le tout début, le biais peut s’introduire : il s’infiltre avec la sélection des données empiriques, se glisse au moment de fixer les paramètres, s’installe dans l’architecture même du modèle. C’est bien pour cela que le recul critique du collectif scientifique ne connaît pas de pause.
Nul ne doit céder sur la transparence. Lorsque l’explication fait défaut, la fiabilité du modèle chancelle. Les exigences réglementaires, à Paris comme à Bruxelles, s’en mêlent : le respect du RGPD, une vigilance accrue sur la protection des données personnelles. Même les maisons d’édition les plus reconnues, de Puf à Gallimard, réaffirment que l’encadrement déontologique ne saurait s’effacer devant la sophistication technique.
Voici quelques repères pour prendre de la distance face à ces systèmes :
- Vérifiez la provenance des données
- Analysez la validité des arguments avancés
- Interrogez la cohérence du raisonnement exposé
Le savoir ne surgit pas d’un chiffre nu. Il se construit dans le dialogue, la contestation, parfois même la remise à plat de tout ce qu’on croyait établi. Un raisonnement, même porté par un modèle d’une incroyable finesse, ne vaut que par sa capacité à reconnaître ses fissures. Les modèles numériques, aussi élaborés soient-ils, rappellent que la curiosité vigilante reste le moteur du progrès scientifique.